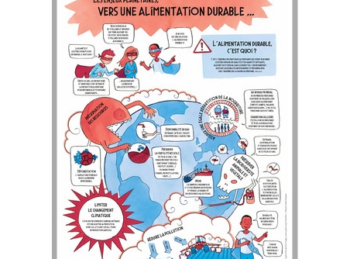Dix ans de lutte contre le gaspillage alimentaire, où en est-on ?
Marie Mourad, sociologue, spécialiste du gaspillage alimentaire a rédigé une thèse en France sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en faisant un comparatif des politiques publiques entre la France et les États Unis et plus particulièrement la Californie qui est l’état le plus à la pointe aux États unis en la matière.Cette thèse a fait l’objet d’un livre Dix ans de lutte contre le gaspillage alimentaire, où en est-on ? publié aux éditions L’Harmattan. Marie Mourad a réalisé 250 entretiens en France et aux Etats Unis, pratiqué des activités de recherche et de conseil, bénévolat pour enrichir sa thèse.
En France, un tiers des aliments est jeté ce qui représente 9 millions de tonnes par an soit 60kg par an au niveau des ménages. Si l’on traduit cela en terme d’impact : cela représente 240 euros/pers/an et 3% d’impact CO2 .Ce gaspillage se confronte à un autre enjeu social puisque 8 millions de personnes en France vivent en dessous du seuil de pauvreté.
La France est le premier pays à avoir voté une loi sur le gaspillage alimentaire avec la Loi Garot en 2016 qui fixe l’obligation pour les commerces de détail alimentaires de plus de 400 m² de proposer une convention de don à une association d’aide alimentaire habilitée et interdiction de détruire des produits comestibles. Malgré cette loi, les mesures sont peu coercitives sur le terrain. La loi AGEC a étendu cette obligation aux opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas/jour), industries agroalimentaires et opérateurs de commerce de gros (> 50 Millions € de chiffre d’affaires annuel),
Le don alimentaire solution gagnant-gagnant ?
Les produits destinés au don alimentaire peuvent être inadaptés en termes gustatifs et nutritionnels au besoin des destinataires. Par exemple, le don de pain et de gâteaux peut être trop riche en sucres rapides et en matières grasses favorisant les risques d’obésité. La réglementation a tendance à générer une augmentation de la quantité au détriment de la qualité. Selon l’Ademe, sur l’ensemble des denrées issues du don, 16% en moyenne seront finalement jetées par les associations et donc non consommées par les bénéficiaires, soit :
- 38 000 tonnes, équivalent à 185 millions d’euros de produits reçus mais qui finissent à la poubelle
- 11 millions d’heures de bénévolat inutiles, pour collecter, trier et jeter ces produits impropres
- 10 millions d’euros de collecte& traitement de déchets pour les collectivités
- 64 millions d’euros de frais de fonctionnement inutiles pour les associations (location, énergie…)
- 65 millions d’euros non perçus par l’État, à la suite des déductions fiscales
Sans compter l’impact du transport et des emballages jetés .
Un autre enjeu est celui de l’accès à l’alimentation avec un côté stigmatisant pour les bénéficiaires qui doivent se rendre sur des lieux spécifiques de distribution et ont un choix limité dans leur alimentation, conditionné par les dons des grandes surfaces. Cette contrainte fait partie des arguments portés par les défenseurs de la sécurité sociale de l’alimentation.
Une re-marchandisation des excédents
Le marché des excédents s’est fortement développé aux cours des dix dernières années avec la création de nombreuses starts up. Un nouveau marché s’est créé avec des acteurs intermédiaires : Phenix, hop hop food, too good to go, Imperfect product (Etats Unis)…Ces structures créent de la valeur par les ventes à prix réduits. Elles concurrencent les associations de dons qui récupèrent moins de produits ou des produits de moindre qualité. Elles ont donc pour effet pervers de diminuer les ressources qui précédemment allaient vers l’aide alimentaire.
Les produits moches, tordus, tâchés, non commercialisés précédemment sont aujourd’hui vendus par des entreprises comme Intermarché, Hors norme, Willy anti-gaspi, Pimp up par exemple. Cette logique de re-standardisation du produit moche le transforme en produit standard qui nécessite un certain volume. Ces produits concurrencent les produits locaux, les AMAP et autres marchés de producteurs. La création de nouveaux circuits marchands, de nouveaux débouchés pour la surproduction pérennise donc cette surproduction puisqu’elle trouve une issue rémunératrice.
Revalorisations de déchets ou sur-cycling
Certains sous-produits anciennement considérés comme des déchets sont aujourd’hui valorisés dans la filière alimentaires comme les drêches pour la fabrication de biscuit, le pain sec pour fabrication de bière ou des biscuits… On peut citer la marque Kignon , Ces nouveaux produits à base de sous-produits ne concurrencent pas en théorie les produits.
Recyclage
Aujourd’hui le recyclage des biodéchets se fait essentiellement par deux moyens : le compostage ou la méthanisation. La méthanisation a été très subventionnée, favorisant ainsi son développement. Or pour qu’un méthaniseur fonctionne bien il a besoin d’être alimenté régulièrement et avec un certain volume. Des produits comestibles sont ainsi destinés au fonctionnement du méthaniseur sans chercher à les valoriser sous forme alimentaire.
Prévenir le gaspillage : des solutions systémiques
Les producteurs surproduisent pour atteindre les exigences strictes des acheteurs. Il est d’ailleurs parfois plus rentable de ne pas récolter les produits. Ces produits ne sont pas comptabilisés dans le gaspillage alimentaire (ce qui reste en champs). Des solutions se trouvent dans des systèmes relocalisés, plus équitables, plus durables en limitant les concurrences entre les structures de dons alimentaires. Il faut offrir un droit à l’alimentation via les politiques et les acteurs publics. Des mesures plus coercitives doivent inciter à limiter le gaspillage plutôt qu’une incitation fiscale de dons. Enfin, la formation en milieu scolaire et professionnelle doit être renforcée.
La Californie un exemple à suivre
La Senate bill 1383 en Californie impose une obligation de partenariats pour le don entre les supermarchés, grossistes, acteurs de la restauration collective et commerciale, acteurs de l’ évènementiel et les associations (différent de la France). Leur application est contrôlée par les collectivités locales qui assurent le suivi des quantités redistribuées, le soutien financier aux infrastructures de redistribution pour les actions de transport, stockage et font également respecter les contrats.
En France, la dynamique a besoin d’être renforcée
Si La France est bien dotée en terme de textes législatifs, des efforts restent à fournir pour obtenir des résultats, Marie Mourad propose plusieurs leviers :
- inciter à respecter réglementation avec des mesures coercitives
- affiner les chiffres (les derniers de l’ADEME datent de 2016) pour mesurer l’évolution
- faire en sorte que les chiffres des observatoires régionaux prennent en compte l’alimentation de manière exhaustive
- assurer un dialogue interministériel entre ministères de l’agriculture, de la transition écologique avec la possibilité de créer un budget commun pour la maîtrise du gaspillage alimentaire
- relancer le pacte national de l’alimentation
- poursuivre les travaux autour du label anti-gaspi pour la restauration collective et les industries Agro-Alimentaires.