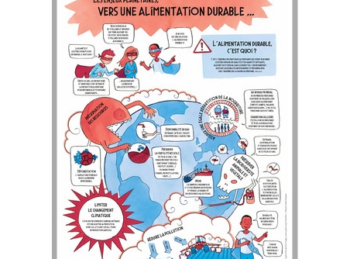Quelles sont les viandes de qualité et durables en Bretagne ?
Depuis le 1er janvier 2024 au moins 60% des viandes et poissons doivent être durables et de qualité dans la restauration collective. Sont concernés tous les restaurants collectifs : qu’ils soient sous la responsabilité de personnes morales de droit public ou de droit privé, y compris les restaurants administratifs des entreprises privées. Ce taux est fixé à 100% pour les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.
Quelles sont les viandes de qualité et durables en Bretagne ?
Le 30 novembre dernier, les participants de la commission restauration collective bio d’IBB ont exprimé de manière unanime que les cuisines collectives bretonnes ne sont absolument pas prêtes. Le respect d’Egalim à 20% de viande bio dans la restauration serait même déjà une première étape. Le coût est bien sûr un premier frein, le manque de disponibilité est également souvent mis en avant. Un second obstacle a été soulevé par la commission : les cuisiniers demandent souvent la même conformation des animaux en bio qu’en conventionnel. Or les races ne sont pas forcément les mêmes, les durées et les modes d’élevage, notamment l’alimentation, sont très différents. Il faut donc aider les cuisiniers à repenser leurs attentes sur de nouveaux critères comme la qualité nutritionnelle des viandes, l’impact sur la santé… Dans la perspective d’un respect de la législation, nous vous proposons un tour de Bretagne des viandes durables.
Les sigles de qualité européens
Il faut dans un premier temps distinguer les SIQO (signes officiels de qualité), régis par l’INAO Institut National des Appellations d’Origine, dont les dispositifs sont définis par la commission européenne. Chaque SIQO est géré par un Organisme de Gestion (ODG) qui va regrouper les parties prenantes (producteurs, transformateurs) qui vont réfléchir ensemble aux règles d’un cahier des charges dans le cadre défini pour chaque SIQO. Celui-ci doit ensuite être validé par l’INAO puis sera instruit par la commission européenne. Le respecte du cahier des charges par les différentes parties prenantes est réalisé par un tiers indépendant, organisme certificateur accrédité par l’INAO. L’INAO gère les AOC/AOP, les STG, les IGP, les labels rouges et l’AB.
Agriculture Biologique
En France, le label AB a été créé en 1985-86, avant d’être remplacé par un label à l’échelle de l’Union européenne en 2010. Le label AB est un label public, il se base sur une réglementation qui couvre toutes les filières dans leur détail. Les grands principes de l’agriculture biologique sont basés sur le respect des cycles de vie et les besoins fondamentaux des animaux. Pour le sol : apport de matières organiques, pas des pesticides de synthèse, respect de la biodiversité et rotation pluriannuelle des cultures. Pour les animaux : respect du bien-être animal et des besoins des animaux, alimentation bio, pas de traitement préventif.
AOP Appellation d’Origine protégée
En 1905, la France crée les appellations d’origine contrôlée [AOC] pour valoriser la gastronomie de haute qualité. En 1992, l’Union Européenne établit une nouvelle réglementation : l’Appellation d’Origine Protégée [AOP], l’équivalent européen de l’AOC, pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les eaux de vie. Les AOP ont un lien fort avec leur terroir d’origine et sont élaborées de façon traditionnelle et ancestrale.
Les AOP bretonnes animales sont les moules de bouchot de la Baie du Mont St Michel, les agneaux de prés salés du Mont St Michel, le bœuf Maine Anjou. Une AOP Gwell est en cours d’étude. D’autres AOP existent en oignon, coco de Paimpol, Farine de Blé noir.
IGP : Indication Géographique protégée
Moins exigeant que l’AOP, l’IGP (indication géographique protégée) atteste d’un lien au territoire : au moins une étape parmi la production, la transformation ou l’élaboration du produit doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée. Les catégories françaises les plus représentées sont celles avec la viande.
Les IGP bretonnes animales sont les Volailles de Bretagne, Les Volailles de Janzé, les Volailles de Normandie, les Coquilles Saint Jacques des Côtes d’Armor, le Porc de Normandie, le Pâté de campagne breton, Le bœuf du Maine, le Bœuf Maine Anjou.
STG : Spécialité Traditionnelle Garantie
La STG (spécialité traditionnelle garantie) valorise la composition traditionnelle d’un produit ou un mode de production sans nécessairement de lien avec une origine géographique. Ce label consacre donc une recette, quel que soit son lieu de fabrication. En France, deux produits sont à ce jour porteurs du label : les moules de bouchot (2013- seule STG présente en Bretagne) et le Berthoud spécialité savoyarde à base de fromage (2020).
Label Rouge
En 1965 a lieu la première homologation “Label Rouge”. Ce signe officiel français garantit une qualité supérieure à celle des produits courants de même nature. La qualité est issue des conditions spécifiques de production ou de fabrication. La qualité supérieure est régulièrement validée par des tests sensoriels et gustatifs, réalisés auprès de panels de consommateurs ou jurys d’experts.
En Bretagne, on retrouve plusieurs labels rouges dont l’agneau de Brocéliande, des labels pour le porc et ses produits : pâté de campagne, rillettes, saucisses, saucissons, jambons … les volailles, les œufs, le veau.
Pêche durable
Depuis 2017, l’écolabel « Pêche Durable » est un signe de qualité qui valorise la pêche respectueuse de l’environnement et du renouvellement des stocks de poissons. Il certifie aux consommateurs que ces produits de pêche répondent à des exigences environnementales, économiques et sociales. Cet écolabel public en France fait suite à la volonté de la filière pêche, en 2007, de créer un écolabel facilement reconnaissable par les consommateurs.
Deux pêcheries de thon rouge de l’Atlantique (une située à Sète, et l’autre située aux Sables-d’Olonne) ainsi qu’une halle à marée et sept entreprises de mareyage commercialisant leur production sont certifiées écolabel « Pêche Durable ».
Une carte de la Région reprend les différents labels officiels et leur location. Retrouvez là ici.
Il existe également un Observatoire des SIQO bretons, rédigé par la chambre régionale d’agriculture.
Les autres sigles de qualité assimilés
Les produits fermiers
Il n’existe pas de définition réglementaire applicable à tous les produits fermiers. La mention « fermier », « produit de la ferme » pour les œufs, les produits laitiers, les volailles de chair s’entend comme mettant en œuvre des méthodes de production traditionnelle dans un circuit intégré à la ferme, en indiquant que les produits doivent provenir principalement de l’exploitation mais également des fermes voisines si l’exploitation conserve un contrôle direct sur les produits. En revanche, peu importe les modalités de commercialisation.
Le fromage fermier est “fabriqué selon les techniques traditionnelles, par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci”.
Les poules pondeuses fermières sont élevées en plein air ou selon le mode de production biologique et doivent être la propriété de l’exploitant qui doit en outre disposer d’autres sources de revenu que la production d’œufs. La taille de l’exploitation est limitée à 6000 poules.
En volailles de chair, le terme « fermier » est réservé aux volailles élevées en plein air et élevées en liberté sous Label Rouge, biologiques ou AOC, à l’exception des volailles issues de production de petite taille et à vente directe ou locale (50 volailles par jour).
Seuls les produits issus de porcs et de bovin élevés selon le cahier des charges Label Rouge peuvent porter la mention « fermier ».
Haute Valeur Environnementale
La Haute Valeur Environnementale a été créée en 2011 par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Ce label garantit que les fruits et légumes sont cultivés en limitant l’utilisation des engrais et des pesticides et favorise la biodiversité. Ce label exige par exemple :
- la préservation de la biodiversité (insectes, arbres, fleurs, haies…) ;
- le recours à des variétés végétales diversifiées ;
- l’utilisation limitée de produits de synthèse (pesticides, engrais, désherbants)
- l’optimisation de l’eau consommée pour la culture de fruits et légumes.
Cette démarche environnementale a pour but de s’adresser à l’ensemble des filières agricoles. Le dispositif se compose de 3 niveaux : le niveau 3 est le niveau le plus exigeant et correspond à la Haute valeur environnementale (HVE). Seule HVE et (CE2 certification environnementale de niveau 2 jusqu’au 31/12/2026) est acceptée dans Egalim.
Hugo Clément révèle la guerre des labels dans “Sur le front”
Nota bene : Ce label est contesté par des associations de consommateurs, environnementales et des fédérations de l’agriculture biologique qui dénoncent « le caractère trompeur du label dans la mesure où la promesse d’excellence environnementale sous-entendue par le nom du label et exigée dans la loi n’est pas toujours remplie par le nouveau référentiel » *. (*extrait Courrier du 23 janvier 2023 – porté par Générations Futures, Fnab, UFC-Que Choisir, Synabio, Bio consom’acteurs, Réseau Environnement Santé et Agir pour l’Environnement).
Bleu Blanc Cœur
Cette démarche est portée par une association et regroupe des éleveurs [7000 déclarés en 2019] dans le but de réintroduire des végétaux naturellement riches en d’oméga 3 [graine de lin, lupin, luzerne, féverole, …] dans l’alimentation des animaux d’élevage. Son slogan : “bien nourrir les animaux pour mieux nourrir les hommes”. L’objectif est de produire du lait, de la viande et des œufs avec un apport nutritionnel renforcé en oméga 3 et de rétablir l’équilibre entre oméga 3 et oméga 6 pour lutter contre cancer, diabète, obésité, Alzheimer, etc.
Nota bene : Selon « Ma Cantine.fr » (site officiel du gouvernement) : A ce jour, pour les produits issus de la démarche Bleu-Blanc-Cœur ne bénéficiant pas d’un signe ou mention « officiel » listé par la loi EGAlim, il est possible de comptabiliser les produits Bleu Blanc Cœur à condition qu’ils soient sélectionnés à l’issue d’un processus de sélection ciblant « les produits acquis selon les modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales tout au long de son cycle de vie » ou « les produits dont l’acquisition a été fondée principalement sur la base de leurs performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ». Le recours à ces modalités de sélection relève du libre choix et de la responsabilité de l’acheteur, dans le respect du code de la commande publiques.